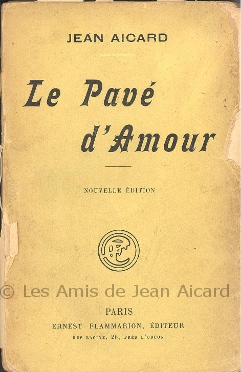Le Pavé d’Amour
Dans son roman «Le Pavé d’Amour », paru en 1892, Jean Aicard écrit l’histoire d’Angèle une petite couturière séduite puis éconduite par un bel officier. Dans ce drame, il relate les angoisses et les problèmes de l’enfant naturel né de cette relation.
Antoine Albalat, écrivain né à Brignoles, ami de Jean Aicard, écrit dans un article intitulé : « Jean Aicard et la Provence »
« Lisez son Pavé d’Amour, un livre d’émotion. Là encore, il est à l’aise comme un maître, avec un art consommé de psychologue et de narrateur. Je ne crois pas qu’on lise ce livre sans avoir les larmes aux yeux. L’exquise nature de l’auteur s’y transfuse à toutes les pages, car c’est presque uniquement de l’enfant qu’il s’agit ici. M. Jean Aicard a, dans cette oeuvre, rajeuni jusqu’à l’angoisse l’éternelle et banale séduction, les questions de maternité et d’enfant naturel. À la façon du chirurgien débridant la plaie, il a courageusement étalé un côté terrible du problème social, les anxiétés de la passion, les agonies de l’amour, l’insoluble problème des liaisons inférieures aux prises avec la paternité, et il a rendu tout cela saisissant par une éloquence convaincue, par des situations extrêmes, par la quantité de réalité et de vie qu’il a donnée à ses personnages. C’est un roman admirablement traité, d’une psychologie bien supérieure à celle de certains livres qui se sont imposés à force de solennité axiomatique et d’alinéas prudhommesques. » La Nouvelle Revue Septembre-octobre 1894
Mais ce Pavé d’Amour est aussi très intéressant par l’hommage que Jean Aicard rend à Toulon, sa ville natale, où il situe cette intrigue.
A la manière d’un chroniqueur ethnologue, il décrit les grandes fêtes et manifestation qui s’y déroulent : la fête Dieu et ses marchandes de belles « ginesto »( genêts) odorantes et lumineuses déversées sur le passage de la procession, une prise d’armes sur la place d’Italie, l’escadre de Toulon quittant les Iles d’Hyères et rentrant dans la rade en simulant l’attaque et la prise de la ville, un concert de la Musique de la Marine. Il n’oublie pas non plus les fêtes patronales au caractère rustique, leurs bals entourés d’arcs de verdure et de fleurs, la messe de minuit à l’église Saint Pierre, une crèche vivante rue de l’Asperge.
Toute cette vie dominée en plein ciel par la haute silhouette du Faron :
« … presque une montagne tout en roches grisâtres, bleutées, violacées sous les transparences jaunes de la lumière du soir, avec de grands plis sombres, verticaux ou obliques, creux de grands ravins plein d’ombre. »
Le carré du Port et son Génie de la navigation, l’Alcazar « ce théâtre de quartier où l’on cherche la lumière, le bruit et les gaîtés fausses des cervelles vides », l’Hôtel Dieu « à l’odeur forte de maladie et de remèdes » dont il décrit la cour avec précision, ne lui font pas oublier les hommes et les femmes qui se côtoient dans ce Toulon qui n’est pas une ville riche.
« A part un ou deux chefs d’usine qui travaillent pour la marine et quelques rares négociants fournisseurs de l’arsenal, tout est petit commerce et employés. Le gros de la population est formé d’ouvriers de l’arsenal. Le reste, soldats et marins. Il y a une aristocratie : c’est l’officier de marine. L’officier de marine a raison d’être fier, il échappe par métier aux trivialités de la vie sédentaire, aux compromissions de la lutte sociale, à toutes les mesquineries de la vie bourgeoise. Les officiers sont une élite française. Aussi ont-ils la juste bienveillance des femmes… A Toulon, épouser un officier de marine c’est le rêve de jeunes filles que les mamans, dit la légende, font tenir bien droites sur les places où ces messieurs se promènent de préférence au Jardin de la Ville ou le soir sur le Champ de Bataille dans l’allée des cafés. »
Jean Aicard n’oublie pas les petites gens, la population ouvrière réveillée en sursaut par le coup de canon du port.
«Dans toute la ville roulait un piétinement étouffé. Une foule de cinq à six mille ouvriers… coulait, muette, vers la porte de l’Arsenal. Fourmilière en marche, sans voix, dont le bruit monotone, par l’uniformité continue équivalait à du silence. Ils ne parlaient guère ou pas du tout, agitant en eux les préoccupations de la veille, celles du jour, un souci d’intérieur, maladie de femme ou d’enfant, terme à payer, manque d’argent…Et ils allaient ainsi, par la pente de la nécessité et de l’habitude, aux chantiers pour fabriquer, ouvriers de détail, les cordages, les clous, les bois qui servent à faire les gros navires et les formidables escadres. »
Quant aux femmes, Jean Aicard choisit de décrire tout d’abord la curieuse corporation des femmes poissonnières et leur lieu de vie dont il dit que c’est « un monument, un temple à elles, qu’elles habitent. Elles vont là, comme les députés à la Chambre, pour travailler, parler et s’injurier…C’est à la Poissonnerie que se tiennent les grandes assises populaires de l’opinion toulonnaise en ce qui concerne du moins les évènements de la ville, ou des environs, qui ont un caractère passionnel… »
Il évoque les tables massives usées par le temps où s’étalent les poissons colorés, où grouillent les crustacés et où s’empilent les coquillages. Le tout, dominé par une forte odeur de mer qui enivre ce « milieu vivant de la vieille cité », est entouré par les maisons vieilles, hautes, populeuses enserrant au plus bas les plus anciennes boutiques de la ville qui s’étalent dans les rues d’alentour portant des noms à caractère : rue des Marchands, des Boucheries, des Bonnetières, des Chaudronniers…
Mais il n’oublie pas que le Pavé d’Amour est le nom d’une spacieuse et vieille rue qui aboutit au quartier réservé. C’est aussi le nom d’une petite place, seuil du Chapeau Rouge :
« …Le caractère très saisissant du Chapeau Rouge, c’est que la prostitution y grouille en pleine rue. Des femmes vêtues d’oripeaux voyants, avec des jupes courtes et fendues, se faisaient voir au seuil des maisons… Quelques unes étaient attablées avec des hommes dans des boutiques ouvertes, basses, étroites…Cà et là résonnaient des fredons de guitares, des tressautements cuivrés de tambours de basque… On ne savait plus si on était en Hollande ou à Tunis ou à Gênes, tant se mêlaient les dialectes et les airs nationaux les plus différents. Rien qu’à voir la joie de ces rues, on devinait que l’escadre était à Toulon. L’escadre était la vie du petit commerce toulonnais, mais surtout la vie du Chapeau Rouge. »